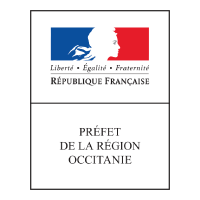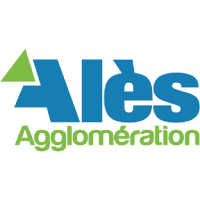Dictionnaire de la Littérature Orale
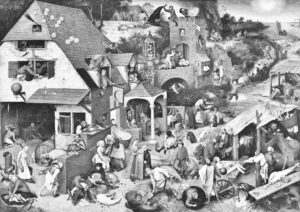
La littérature orale
Mythes, épopées, légendes, contes, chants, proverbes, devinettes…constituent, dans le patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, ce que le CMLO définit comme littérature orale
L’officialisation d’un oxymore
Le terme et le concept de littérature orale est un oxymore que l’histoire (ou la légende) attribue en général à Paul Sébillot.
Celui-ci en 1881, à la suite de recherche et d’une collecte en Bretagne, se trouva fort embarrassé pour donner un titre à sa publication. En effet, les récits qu’il avait recueillis n’étaient pas des écrits, mais ils avaient volonté de faire œuvre et étaient tous très stylisés. De plus, malgré quelques variations, beaucoup étaient construits sur un même socle, sur un même type de structure…
Ces récits étaient-il littéraires ou pas ? Ne voulant pas trancher, il intitula alors sont ouvrage « Littérature orale de la Haute Bretagne ». L’expression fit fortune en France puisqu’une chaire de littérature orale existe de nos jours et que de nombreuses revues scientifiques utilise cette terminologie.
Les linguistes (Claude Hagège, Remi Dor…) préfèrent à cette expression un terme un peu plus rugueux, mais peut-être plus efficace, celui d’« Orature » (voire d’Oraliture Chamaseau). Ce terme a l’avantage de créer un parallèle de création narrative qui n’entretient pas de confusion avec l’écriture. Mai ceci ne nous dit pas vraiment ce qu’est la littérature orale.
La définition est toujours difficile dans le sens où, comme souvent, chaque utilisateur tend à la définir en fonction de sa pratique.
Geneviève Calame-Griaule (ethnolinguiste et directrice de publication des « Cahiers de littérature orale ») la définit ainsi :
La littérature orale est la partie de la tradition qui est mise en forme selon un code propre à chaque société et à chaque langue, en référence à un fonds culturel […] La mise en forme codifiée du fonds culturel est déterminée par des genres dont chacun obéit à des règles déterminant le mode d’énonciation […] et la structure […] Cette littérature vise à la permanence, à la stabilité, à la fidélité ; elle n’est pas censée inventer mais reproduire. Ce souci de permanence va cependant de pair avec une variable de fait, qui s’explique par des mutations historiques et sociales aussi bien que par une relative création individuelle, celle-ci restant généralement cantonnée au domaine de la forme…
La littérature orale est généralement caractérisée par le fait que les récits qui la composent sont anonymes, semi fixés, objets de variantes.
La littérature orale est une matière vivante d’une richesse infinie. Dans l’optique du CMLO, ce véritable trésor de l’humanité est abordé dans quatre dimensions :
Sa répartition en genres qui sans être étanches ont des intentions, des orientations et des fonctions particulières que l’on retrouve à des niveaux différents dans différentes civilisations.
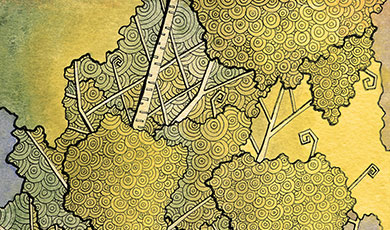
Sa réalité culturelle. Même si les genres ont des dimensions universelles, ils sont malgré tout producteurs de récits ancrés dans une culture singulière. Cette relation au contexte est essentielle pour aborder correctement ce type de littérature.

Ses applications contemporaines. De tout temps, les récits de la littérature orale ont permis à des communautés de se distraire, mais aussi de transmettre des codes, des valeurs, des représentations, des logiques symboliques fondatrices de la cohésion sociale du groupe. Aujourd’hui encore cette littérature peut avoir des fonctions bénéfiques multiples.

Sa dimension artistique.
La diffusion du néocontage à partir des années 1980 a développé la figure d’un conteur de nouvelle génération qui, tout en prenant en compte la performance de son spectacle, n’oublie pas les racines auxquelles il puise pour réaliser son travail.


Les genres
Le travail de recherche du CMLO, en s’appuyant sur les études de chercheurs, universitaires, conteurs, collecteurs de terrain qui se sont intéressés à la littérature orale a mis en lumière différents genres dans lesquels la littérature orale s’articule.
Une hypothèse travaillée par le Centre Méditerranéen de Littérature Orale, depuis déjà de nombreuses années, c’est que chaque genre de la littérature orale serait en fait porteur d’une fonction spécifique qui lui donnerait sa structure et sa forme. Cette spécificité serait moteur de la création d’une forme narrative propre à chaque genre, mais aussi de modes spécifiques de narration et d’adresse à l’auditoire.
Les ancrages
Les différents genres et œuvres de la littérature orale sont ancrées profondément dans un contexte social, culturel et géographique qui leur sont propres. Il est impossible d’en saisir la complexité en faisant abstraction des sociétés et des cultures dans lesquelles ces œuvres ont pris vie. Le CMLO a donc analysé les différents ancrages de la littérature orale dans le but d’une compréhension qui va au-delà de ces mêmes frontières.


Les applications
L’’oralité et la littérature orale sont aujourd’hui’’hui reconnues comme des éléments importants dans le cadre du développement social et culturel de chaque individu. Au-delà de la culture écrite, elles permettent de conscientiser la valeur de la parole dans l’’acquisition des savoirs, dans la structuration de l’’humain et dans ses relations quotidiennes. Elles mettent aussi en exergue un patrimoine immatériel universel important pour l’’histoire de l’’humanité. Les représentants des Ministères de la Culture et de la Communication, de l’’Éducation Nationale, et de la Francophonie ont ouvertement témoigné leur volonté de prendre en compte ces disciplines dans leurs projets.
Une approche transdisciplinaire